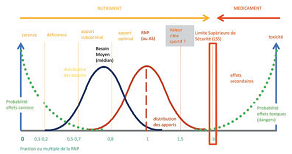

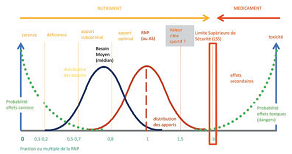
S’il est indéniable que l’activité physique et a fortiori la pratique sportive modifient les besoins en nutriments (1), le bénéfice attendu des supplémentations n’est pas forcément au rendez‐vous et peut altérer les réponses adaptatives à l’entraînement voire présenter des risques pour la santé.
L’attente du sportif est le plus souvent liée à des allégations, certes encadrées par un règlement européen (2), mais parfois implicites, sur la santé ou sur la performance (3). Ces promesses peuvent conduire à la consommation de compléments alimentaires ou d’aliments enrichis en vitamines, minéraux ou autres substances à but nutritionnel alors que la vocation de ces denrées se limite à compléter les apports insuffisants d’une alimentation courante. Ainsi, classés parmi les aliments, ils ne devraient avoir d’autre finalité que d’apporter des nutriments à des personnes dont l’alimentation habituelle ne permettrait pas de couvrir les besoins nutritionnels. Au‐delà de ces allégations, l’idée selon laquelle la pratique sportive conduit à des déficits d’apports voire des carences est particulièrement répandue et renforce ainsi la tendance à se tourner vers ces produits parfois inadaptés, voire adultérés par des substances interdites (4).
L’exposé vise à démontrer le rôle central de l’alimentation courante dans la nutrition du sportif, la fragilité des allégations, leur caractère parfois trompeur, et documente les risques sanitaires liés à la consommation de compléments alimentaires analysés par le système de Nutrivigilance de l’Anses (5) plus spécifiquement chez le sportif (6).
Vidéo de la conférence (durée : 29:58)
Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.
Références :