L’électrolyse, une solution pour protéger l’environnement. L’étude des réactions forcées permet de mettre en place des procédés industriels permettant de produire des espèces chimiques (hydrogène, dichlore, soude, etc.), de traiter des métaux comme le cuivre, le fer ou encore de fabriquer des accumulateurs, en accord avec le respect des principes de la chimie verte.
Terminale - STL (Spécialités PCM et SPCL)
Objectifs : Comprendre comment il est possible de faire évoluer un système chimique dans le sens contraire de son sens d’évolution spontané en imposant une tension électrique entre deux électrodes plongeant dans une solution électrolytique.
Appréhender quelques-unes des applications industrielles de l’électrolyse.
Transformation chimique de la matière / réactions d’oxydo-réduction
Notions et contenus : Réaction d’oxydo-réduction ; demi-pile, pile, anode, cathode.
Synthèse chimique / aspect microscopique
Notions et contenus : Électrolyse, électrosynthèse, applications courantes, rendement faradique.
Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie
Pourquoi mesurer la radioactivité ? Dans la nature, la plupart des noyaux d’atomes sont stables, c’est-à-dire qu’ils restent indéfiniment identiques à eux-mêmes. Les autres sont instables car ils possèdent trop de protons ou de neutrons ou trop des deux. Pour revenir vers un état stable, ils sont obligés de se transformer. Ils expulsent alors de l’énergie – provenant de la modification du noyau – sous forme de rayonnements : c’est le phénomène de la radioactivité.
Les recherches sur la radioactivité ont contribué à la connaissance de la matière, permis de reconstituer l’histoire de l’Univers et de la Terre et procuré des marqueurs, outils et instruments irremplaçables en biologie, médecine et géologie.
Les propriétés de la radioactivité et les nombreuses applications qui en ont découlé sont de plus en plus présentes dans notre vie quotidienne : la production d’électricité, les diagnostics médicaux, l’astronomie…
Les éléments radioactifs sont également d’excellents chronomètres : la décroissance radioactive et la mesure de l’activité fournissent ainsi des « horloges » destinées à dater des événements plus ou moins anciens. C’est ce dernier point que nous allons étudier dans ce dossier.
Terminale - Spécialité PC
Objectifs : Expliquer le principe de la datation à l’aide de noyaux radioactifs et dater un événement.
Constitution et transformations de la matière
Thème 3 • Prévoir l’état final d’un système, siège d’une transformation chimique.
Partie B • Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation nucléaire.
Notions et contenus : Évolution temporelle d’une population de noyaux radioactifs ; constante radioactive loi de décroissance radioactive ; temps de demi-vie ; activité.
Radioactivité naturelle ; applications à la datation.
Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie
 |
Enfin un masque invisible
|
Enfin un masque invisible
Rubrique(s) : Éditorial
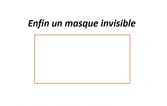
La chimie n’arrête pas d’innover pour le bien de nos concitoyens en cette période de pandémie où les gestes barrières et le port du masque sont essentiels. Le manque de visibilité des visages apporté par les masques classiques en polyéthylène (1) est sur le point d’être contourné. Le professeur Vandensoep et son équipe de l’institut de Gand–Wevelgem, après plus de 12 mois de recherche, viennent enfin de publier des résultats sur un masque totalement transparent quasi invisible.
Après plusieurs essais sur des masques en polyéthylène multicouches directement issus de l’emballage alimentaire (2) on s’est aperçu que les couches filtraient bien l’oxygène mais pas l’azote et le gaz carbonique rejetés par les voies respiratoires, ce qui a failli entraîner des accidents heureusement sans grande gravité chez les volontaires testés. Ces essais malheureux ont cependant été très instructifs et ont conduit à l’élaboration de plusieurs prototypes.
Le masque est composé d’une mince feuille de polycarbonate percée de milliers de nano-trous et revêtue à l’extérieur d’une couche de polymères possédant une chaine perfluorée qui assure la « déperlance » (3) du masque. Ainsi l’air inspiré et les gaz expirés peuvent circuler mais les micro-gouttes des aérosols extérieurs, véhicules du virus, sont arrêtées et regroupées en macro-gouttes, tout en conservant la transparence du masque. Sa dénomination commerciale se ferait sous la marque Carat.
Le débit d’inspiration et d’expiration doit cependant faire face à une perte de charge due aux dimensions de nano-trous, c’est alors que l’équipe du professeur Vandensoep a eu l’idée de collaborer avec celle du professeur Trugludu de l’Université libre de Roubaix, spécialisée dans l’optique et notamment dans les micro-lasers. Ils ont alors augmenté les diamètres de micro-trous afin de diminuer la perte de charge et placé au-dessus des oreilles des micro-lasers (4) alimentés par des cellules photoélectriques disposées sur un serre-tête du porteur du masque qui balayent la partie avant du masque et font éclater toutes les gouttes des aérosols meurtriers. Sa dénomination commerciale est prévue sous le nom de Carré, compte tenu de sa forme plus anguleuse.
C’est alors, vu la complexité et surtout le coût de ce dernier masque, que l’idée de faire appel à des polymères autoréparables est venue à l’équipe, en utilisant des polymères à liaisons covalentes réversibles associant un réseau de type silicone et un autre réseau supramoléculaire (5). La mince feuille de polycarbonate est alors revêtue de cette couche autocicatrisante. Les trous de cette dernière pouvant être obturée par la simple chaleur de l’air expirée. L’équipe a alors donné à ce prototype le nom de « dArpone d» qui rappelle la base silicone, il demande encore à être testée pour la réversibilité des cycles.
Nul doute que d’ici peu les masques chirurgicaux difficiles à porter seront remplacés par ces masques qui permettront de mieux visualiser les visages et contribuer à la vie sociale. Souhaitons rapidement la fabrication des masques Carat, Carré et Arpone pour le bien-être et la sécurité de nos concitoyens.
Jean-Claude Bernier
1er avril 2021
Pour en savoir plus
(1) Oui la chimie avance masquée
(2) Chimie et maîtrise de la lumière
(3) Les textiles et les vêtements pour le sport
(4) La chimie à la lumière du laser : un intérêt réciproque
(5) Matériaux et chimie supramoléculaire (vidéo)
Des batteries écologiques et recyclables pour concurrencer le marché chinois : c’est possible grâce à une start-up française. Comment sont-elles conçues ?
Source : Clins d'oeil de la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie
Présentation de l’unique autobus à hydrogène fabriqué en France, commercialisé et en service depuis 2019. Ce bus Zéro émission a une autonomie de 350 km, fonctionne avec un moteur électrique de 250 kW alimenté par une pile à hydrogène de 30 kW qui utilise une réserve de 30 kg d'hydrogène.
Source : Clins d'oeil de la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie
 |
De la fragilité des réseaux électriques
|
De la fragilité des réseaux électriques
Rubrique(s) : Éditorial

Les vagues de froid
Février 2021 a vu une météo très changeante et des vagues de froid vif en Europe du Nord et sur le continent américain. Des chutes importantes de température, accompagnées de chutes de neige abondantes, ont sévi en Scandinavie, au Canada et sur la côte Est des États-Unis. Plus surprenant un anticyclone arctique est descendu en Amérique au-delà de la Nouvelle-Angleterre et jusqu’au Texas. Des températures polaires de -19°C à -9°C et même -41°C dans le Minnesota ont été relevées alors même que neige et verglas paralysaient la circulation. Six états US ont déclaré l’état d’urgence grand froid et plus de 3 millions de foyers au Texas ont été privés d’électricité durant plus de 48 h (1) ainsi que d’eau courante pour plusieurs semaines, l’eau ayant gelé dans les canalisations.
En Europe, la Scandinavie a aussi été frappée d’une vague de froid qui a un peu débordé sur la France et le nord-est de l’Allemagne. La vertueuse Suède qui a remplacé ses centrales thermiques et nucléaires par des filières renouvelables (2) a vu tomber leur production électrique de 25% à 9%, les éoliennes étant gelées et les panneaux photovoltaïques enneigés. Pour échapper au black-out elle a remis en route la centrale au fioul et a eu recours à de l’électricité venue d’Allemagne, de Pologne et de Lituanie, las issue de centrales à charbon ! Les Suédois et Suédoises ont été invités par le gouvernement à réduire leur consommation, ce à quoi ils et elles ont répliqué par « #dammsugarupproret », soit « la révolte des aspirateurs ».
Les causes
On peut s’étonner que dans un État aussi riche en sources d’énergie qu’est le Texas, un black-out généralisé puisse arriver. Les hommes politiques ont été très interpellés à la suite de ces incidents qui ont tout de même fait plus d’une dizaine de morts. Certains ont pointé le pourcentage trop élevé de sources d’énergie intermittentes. La société privée de distribution ERCOT a fait l’objet de nombreuses critiques soulignant ses faibles investissements sur les lignes et le grand défaut du manque d’interconnexions avec les sources d’énergies d’autres États et au réseau national (3).
C’est là la grande différence avec l’Europe. Pour la France, une vague de froid fin 1978 avait provoqué une panne d’électricité générale le 19 décembre où les trois quarts du pays avaient été privés de courant durant une dizaine d’heures, alors que commençaient à produire les premières centrales nucléaires et que l’interconnexion des boucles de distribution était encore incomplète.
La leçon à cette date fut bien comprise. Il fut décidé d’accélérer le programme nucléaire et de parfaire une interconnexion européenne qui autorise les échanges de puissance électrique entre pays permettant de pallier des incidents locaux ou des conditions climatiques géographiques particulières. Il y a donc en Europe un marché d’échange du MWh qui, lors de la vague de février, est brutalement monté à 200 € au lieu de 30 €.
Les solutions
Au-delà de la toile d’araignée des interconnexions de grandes lignes de courant, il y a une réflexion sur notre avenir énergétique dans la perspective de la transition écologique. L’intermittent éolien et solaire n’est viable que s’il est soutenu par une source d’énergie constante (4) et modulable facilement suivant la demande et si possible non polluante. À ce sujet connaître la valeur en émission CO2 du KWh est cruciale (voir tableau ci-dessous).
| Filière | nucléaire | hydraulique | gaz | fioul | charbon |
| G CO2/kWh | 6 | 6 | 418 | 730 | 1060 |
Pour les producteurs et régulateurs de réseau c’est un vrai casse-tête car comment ajuster en temps réel demande et production et comment faire face à des conditions extrêmes - froid intense, neige et glace et anticyclone permanent - sans vent durant plusieurs jours (5) ? Les centrales thermiques à gaz ou fioul peuvent répondre assez vite mais comme elles ne fonctionnent que quelques jours par an, leur kWh est cher et peu d‘investisseurs sont enclins à s’y intéresser. De plus leur bilan carbone n’est pas bon. En France l’hydraulique peut répondre assez vite à ces hausses de demande. Pour le nucléaire, actuellement le CEA et EDF planchent sur un procédé de variation rapide de 20% à 80% de la puissance d’un réacteur en moins d’une heure (6). Par ailleurs la recherche et quelques réalisations de SMR (petits réacteurs modulaires) vont permettre de diversifier les applications nucléaires de puissance comprises entre 100 et 300 MW et répondre à ces types de demandes (7). Le projet français « Nuward » vient de bénéficier financièrement du plan de relance. Il regroupe le CEA, EDF, TechnicAtome et Naval Group. Avec deux ilots de 170 MW et une seule salle de commande, il sera le plus compact du marché dans une cuve de 4 m de diamètre et de 13,5 m de hauteur dans un bâtiment semi enterré associé à un système de refroidissement passif (sans pompes) garantissant une sureté et une protection de qualité. Modèle le plus compact issu de notre expérience de la propulsion navale, il pourrait être commercialisé en 2035 avec une chaine de fabrication modulaire et standardisée permettant des coûts réduits. Il ne faut pas tarder, car selon l’OCDE/AEN le marché des SMR à cet horizon peut être de 20 GW. Déjà la Russie a installé un SMR sur barge flottante en Sibérie et aux États-Unis la société NuScale prévoit d’installer un premier module en Utah en 2023.
Sur le papier nos gouvernants et l’opinion publique pensent qu’il est simple d’élaborer une transformation énergétique radicale de la société, sur le terrain c’est une autre affaire… (8)
Jean-Claude Bernier
Mars 2021
Pour en savoir plus :
(1) Noël aux tisons ? editorial Jean-Claude Bernier
(2) Une électricité 100% renouvelable : rêve ou réalité ? fiche Chimie et… en fiches
(3) Réseaux de transport de l’électricité et transition énergétique, article et conférence de S. Henry (colloque Chimie et enjeux énergétiques, 2012)
(4) Le challenge de l’électricité verte, collection Chimie et Junior
(5) La complexité du réseau et l’électricité verte, article et conférence de Y. Bréchet (colloque Chimie et enjeux climatiques, 2015)
(6) Équipe de recherche (vidéo du CEA)
(7) Le nucléaire de fission dans le futur. Complémentarité avec les renouvelables, conférence de C. Behar (colloque Chimie et énergies nouvelles, 2021)
(8) Vitesse de déploiement et acceptabilité des nouvelles technologies dans le domaine des énergies, conférence de G. de Temmerman (colloque Chimie et énergies nouvelles, 2021)
Image d'illustration : K. et B. Emerson - Flickr
licence Creative Commons Attribution 2.0 Générique.
 |
Les pigments
|
Les pigments
Rubrique(s) : Zoom sur...

Un pigment est un matériau insoluble dans le milieu dans lequel il est dispersé alors qu’un colorant y est soluble.
Les matières colorantes absorbent la lumière dans un domaine de longueur d’onde compris entre 400 et 750 nm. Les origines de la couleur sont liées aux structures chimiques de ces substances […]
Nous utilisons dans notre vie moderne plus de 110 000 molécules ou produits différents dont il reste obligatoirement des traces plus ou moins importantes dans l’air, le sol, les aliments et finalement l’eau qui joue un peu le rôle de réceptacle final de toute cette pollution environnementale.
Terminale - Spécialité PC
Objectifs : Savoir réaliser un titrage.
Comprendre les enjeux de la chimie analytique.
Constitution et transformations de la matière
Thème 1 : Déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et chimiques.
Partie B : Analyser un système chimique par des méthodes physiques.
Notions et contenus : Titre massique et densité d’une solution.
Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie
ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, est un projet international qui a pour but de maîtriser une réaction nucléaire hors du commun : celle des étoiles. Actuellement, les centrales nucléaires, elles aussi, exploitent une réaction nucléaire : la fission.
Quels avantages apportera le projet ITER par rapport à la fission déjà à l’oeuvre en France dans la production d’électricité ?
Terminale - Spécialité PC
Objectifs : Déterminer, à partir d’un diagramme (N,Z), les isotopes radioactifs d’un élément.
Utiliser des données et les lois de conservation pour écrire l’équation d’une réaction nucléaire et identifier le type de radioactivité.
Constitution et transformation de la matière
Thème 3 : Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation.
Partie B : Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation nucléaire.
Notions et contenus : Stabilité et instabilité des noyaux : diagramme (N,Z), radioactivité α et β, équation d’une réaction nucléaire, lois de conservation.
Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie
La préoccupation de limiter les conséquences des évènements accidentels ou criminels conduit les autorités à mettre en place des unités capables d’intervenir rapidement en ayant recours à des analyses sur le terrain nécessitant la mise en oeuvre de moyens technologiques innovants et performants. En dehors d’évènements accidentels, en cas de détournement deproduits ou de processus, des actions humaines délibérées peuvent être à l’origine d’évènements très meurtriers car destinés à l’être, et aux conséquences matérielles importantes.
Il est donc nécessaire de mettre en place des moyens efficaces de neutralisation et de décontamination des lieux pour permettre un retour à la normale et participer à la sécurité et à l’efficacité des intervenants sur le terrain (services de secours et police) par le conseil du port de tenues de protection adaptées au risque identifié. Il s’agit dans la phase de détection d’évaluer les risques radiologique, biologique et chimique par la mise en oeuvre de capteurs qui répondent de manière plus ou moins spécifique en présence des substances présentes.
L’analyse et l’identification des espèces chimiques est, par conséquent, un maillon essentiel sur lequel nous allons nous attarder dans ce dossier.
Terminale - Spécialité PC
Objectifs : Compléter les méthodes d’analyse chimique abordées en 1re.
Identifier un groupe caractéristique grâce à des méthodes d’analyse chimique : la spectroscopie UV-visible et l’I.R.
Constitution et transformation de la matière
Thème 1 : Déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et chimiques.
Partie B : Analyser un système chimique par des méthodes physiques.
Notions et contenus : Spectroscopie infrarouge et UV-visible.
Identification de groupes caractéristiques et d’espèces chimiques.
Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie





