Présentation des quatre catégories de bio-contrôle dans la protection intégrée des cultures : macroorganismes, micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles. Les atouts et les limites.
Source : Une vidéo de la série Chimie et agriculture durable pour tous
Un panorama des techniques associant chimie et agriculture.
Source : Une vidéo de la série Chimie et agriculture durable pour tous
L’intégration de l’innovation technologique dans le monde agricole va de pair avec l’évolution des mœurs et des mentalités.
Source : Une vidéo de la série Chimie et agriculture durable pour tous
Une introduction faisant appel aux grandes figures du passé - Pasteur, Boussingault- pour raconter les relations entre la chimie et l’agriculture.
Source : Une vidéo de la série Chimie et agriculture durable pour tous
Diffusion en différé du colloque Chimie et Énergies nouvelles du 10 février 2021
Rubrique(s) : Événements
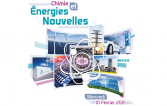
Vous pouvez assister en différé au Colloque Chimie et Énergies Nouvelles sur Youtube.
Les vidéos sont également disponibles et téléchargeables, conférence par conférence, sur cette page dédiée.
Session du matin
Session 1 de l'après-midi
Session 2 de l'après-midi
ll y a urgence que le système mondial de production, distribution et consommation d’énergie soit engagé sur une trajectoire dont les effets seront déterminants pour l’avenir de la planète et celui de ses habitants en limitant ses effets sur le climat : le sujet est plus que jamais au coeur des préoccupations de la Société, notamment de la recherche et de l’industrie. Malgré l’engagement politique des États et la progression des énergies dites « vertes », notamment du solaire électrique ou thermique et de l’éolien offshore pour lesquels on s’attend à des facteurs de croissance record dans les prochaines décennies, toutes les énergies flexibles, propres, abondantes, décarbonnées seront nécessaires pour faire face aux besoins toujours croissants de la demande en énergie. Pour cela il est urgent d’innover, mais aussi d’optimiser les technologies existantes en lien avec l’objectif d’un développement durable garantissant l’accès de tous à des services énergétiques fiables à des coûts abordables.
Nous avons souhaité dans ce 25e colloque « Chimie et… » faire un point scientifique objectif sur une évolution possible du « bouquet énergétique diversifié » en cours de développement.
Les conférenciers ont été choisis parmi les experts les plus qualifiés dans les différents domaines concernés, la recherche, l’industrie, la politique et l’économie.
Le niveau se veut accessible à tous pour permettre un large débat.
Bernard Bigot
Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie
et Directeur Général de l’Organisation internationale ITER
 |
Par grand froid la chimie vient à votre secours
|
Par grand froid la chimie vient à votre secours
Rubrique(s) : Éditorial

Ce début février est marqué par le retour de températures hivernales classiques et négatives. C’est alors une floraison dans tous les journaux papiers ou télévisés d’une série de reportages et conseils plus ou moins pertinents liés à ces basses températures. Pourquoi Mediachimie ne s’y mettrait pas avant que le mercure ne remonte !
Chez vous
Pour un bon cocooning, vérifiez bien que l’isolation de votre maison est bonne. C’est d’abord 15 à 20 cm de laine de verre ou de cellulose dans vos combles qui vous font économiser 30% sur la fuite des calories (1). Les vitrages à haute isolation de vos baies vitrées et fenêtres avec deux lames de verre sodo-calciques séparées par un volume d’argon et disposant sur l’une des faces intérieures d’un micro-revêtement métallique renvoient les infrarouges vers l’intérieur et évitent de chauffer le jardin (2). Si vous avez un chauffage électrique vos murs sont équipés de contrecloisons en plâtre munies d’une bonne épaisseur de polystyrène. Pensez aux radiateurs à accumulateurs de chaleur qui, équipés d’une âme de céramique (silico-aluminates de calcium) chauffée la nuit, restituent ses calories le jour. Grâce à la chimie des matériaux vous économisez les kWh tarif nuit.
En voiture
Attention, au démarrage n’oubliez pas que votre bonne vieille batterie au plomb perd 33 % de sa puissance lorsqu’on atteint –5°C (3). Si vous roulez au diesel vérifiez bien que vous avez fait le plein à la pompe avec le gas-oil hiver qui a un point de cristallisation à –15°C et qu’il ne vous reste plus du gas-oil été (qui cristallise à 0°C), bien que pour des raisons commerciales il semble que certaines marques fournissent un carburant unique été – hiver. Si vous roulez à l’éthanol (E 85) le démarrage à froid est parfois plus difficile car les vapeurs d’alcool sont moins inflammables. Les pétroliers diminuent en hiver la proportion d’éthanol qui peut descendre à 60% eu lieu de 85% en été (4).
Assurez-vous que le liquide de refroidissement (souvent appelé antigel) de votre moteur est bien adapté à l’hiver afin qu’il ne gèle pas dans votre réservoir. Mélanges d’eau, d’éthylène glycol ou de propylène glycol et d’additifs, ils peuvent supporter sans geler des températures pouvant descendre à –25°C ou moins selon les proportions (5).
Si la route est glissante à cause du verglas, heureusement les municipalités et la DDE ont salé les revêtements (6). Mais roulez avec des pneus hiver qui ont une gomme tendre à base de caoutchouc naturel et de mélanges butadiène / acrylonitrile. En effet suivant la composition la température de transition vitreuse est abaissée et par temps froid le pneu reste souple procurant une meilleure tenue de route (7).
Si le matin vous déneigez carrosserie et pare-brise, utilisez une raclette en polystyrène ou polypropylène moins dure que le verre ou le vernis de peinture pour ne pas faire de rayures. Pour la couche de glace sur le pare-brise, une « pulvérisette » d’alcool ménager vaut mieux que l’eau chaude car le mélange eau – alcool se solidifie à bien plus basse température que 0°C. Enfin si les montants de portes ont leurs joints caoutchouc collés, pensez à les enduire d’une fine couche d’éthylène glycol qui tiendra jusque –45°.
À pied dehors
En promenade ou pour faire vos courses n’hésitez pas à vous couvrir en multicouches (8) :
- des sous-vêtements en microfibres très légers, des maillots en fibres creuses qui vont emprisonner de l’air qui est un isolant thermique efficace pour protéger du froid ;
- un « pull polaire » en fibres polyesters aérées qui viennent en partie du recyclage des bouteilles plastiques en PET ;
- une veste en textile imper respirant, imperméable à la pluie ou la neige mais laissant passer la transpiration, obtenu après enduction de polyuréthane ou des membranes hydrophobes comme les polyfluorothylène (9) ;
- ou mieux encore des textiles thermorégulants à changement de phase où sont encapsulées sur les fibres des cires qui se liquéfient à plus de 37°C lorsque vous êtes dans une pièce chauffée et qui, quand vous sortez à l’extérieur au froid, se solidifient en libérant de la chaleur.
On trouve aussi des vêtements et gants pour motards ou artisans du BTP avec des microcircuits de résistances alimentées par des piles ion-lithium qui sur commande peuvent chauffer soit les mains, soit le dos.
En cette période de COVID, vous sortez avec les masques sanitaires en polypropylène qui comportent une couche de « meltblown », microfibres qui par attraction électrostatique captent les nano-gouttes des aérosols pouvant véhiculer le virus (10). Si les masques sont humides les fibres ne servent plus de barrière, donc éviter de les mouiller par la respiration en hiver ou sous la pluie ou la neige. L’Académie de médecine canadienne recommande par grand froid de porter au-dessus une écharpe.
Mais que cela ne vous empêche pas de soigner votre visage et votre peau : par grand froid sec, elle souffre, alors n’oubliez pas les crèmes hydratantes et les rouges à lèvres protecteurs (11).
Parés pour le grand Nord ?
Jean-Claude Bernier
Février 2021
Pour en savoir plus
(1) Isolation dans l’habitat : la chimie pour ne pas gaspiller de calories !
(2) Les vitrages : laissez entre la lumière
(3) Applications présentes et futures des batteries
(4) Pourquoi met-on de l’alcool dans l’essence ? (Question du mois)
(5) Glycol / Éthane-1,2-diol / Éthylène glycol (Produit du Jour Société Chimique de France)
(6) Pourquoi met-on du sel sur les routes lorsqu’il gèle ? (Question du mois)
(7) Le pneumatique : innovation et haute technologie pour faire progresser la mobilité
(8) Vers des textiles intelligents pour des vêtements performants et innovants
(9) Les textiles imper-respirants
(10) Oui la chimie avance masquée
(11) La peau au quotidien : protection et embellissement
 |
Pourquoi la levure chimique fait-elle lever les gâteaux ?
|
Pourquoi la levure chimique fait-elle lever les gâteaux ?
Rubrique(s) : Question du mois

Hum ! Un beau gâteau bien gonflé ! Les recettes des cakes, quatre-quarts, madeleines, cookies… nécessitent de la levure dite « chimique ». De quoi s’agit-il et à quoi sert-elle ?
Tout d’abord le mot « levure chimique » est utilisé pour se différencier de la « levure de boulanger » dont l’action est due à des microorganismes.
Pourquoi ajouter de la levure chimique ?
L’objectif de la levure chimique est de libérer un gaz lors de la cuisson afin de faire gonfler la pâte du gâteau. C’est ainsi que ces sachets sont aussi surnommés « poudre à lever » ou « poudre levante ». Dans la pratique ce gaz est le dioxyde de carbone (ou gaz carbonique), CO2. Il est obtenu par une réaction acidobasique une fois que la levure est mélangée aux ingrédients et humidifiée.
Que contiennent les sachets de levure chimique ?
Citons quelques compositions indiquées. Vous reconnaitrez sans doute celle que vous avez achetée :
- diphosphate disodique, carbonate acide de sodium, amidon de blé ;
- pyrophosphate disodique, bicarbonate de sodium, amidon de blé ;
- diphosphate disodique, bicarbonate de soude, amidon de maïs ;
- diphosphtates et carbonates de sodium, farine de blé ;
- pyrophosphate de sodium, bicarbonate de sodium, farine de froment (ancienne formule) ;
- acide tartrique, bicarbonate de soude, fécule de maïs (ancienne formule) ;
- crème de tartre, carbonate acide de sodium, fécule (ancienne formule).
À première vue ces compositions semblent différentes. Regardons de plus près.
Le bicarbonate de sodium, le carbonate acide de sodium et le bicarbonate de soude sont en réalité le même composé chimique dont le nom précis est l’hydrogénocarbonate de sodium et qui a pour formule chimique NaHCO3 (ou Na+, HCO3-) (i). C’est l’ingrédient commun indispensable. C’est lui qui permettra de libérer le dioxyde de carbone en jouant un rôle de base.
Les termes diphosphate disodique et pyrophosphate disodique concernent le même composé de formule Na2H2P2O7 (ii). L’acide tartrique a pour formule C4H6O6 (iii) et la crème de tartre KC4H5O6. Ce sont tous les trois des composés au comportement acide en présence d’eau.
La farine de froment, l’amidon de blé ou la fécule ou l’amidon de maïs contiennent tous de l’amidon [1]. Il est nécessaire à la conservation ou stabilisation du produit avant usage en limitant la réaction chimique entre les deux autres constituants et en absorbant l’humidité. Il est donc très important que le sachet soit conservé au sec.
Lors de la réalisation de la recette, il est aussi nécessaire de mélanger à sec la levure à la farine avant l’ajout des ingrédients humides.
L’ajout d’eau
Quelle que soit la recette, l’ajout d’eau est indispensable. Elle est apportée soit avec les œufs (l’eau représente 75% de la masse d’un œuf), soit avec un jus de fruit, du lait, ou tout simplement de l’eau seule…) . Elle dissout les acides et les bases contenus dans la levure, facilite le malaxage des ingrédients et la mise en contact des réactifs.
Le gonflement : quelles réactions ?
Une réaction entre acide et base
Une fois tous les ingrédients de la recette bien mélangés, les acides présents échangent un proton H+ avec le bicarbonate selon, par exemple :
H2P2O72- + HCO3- → CO2 (gaz) + H2O + HP2O73-
Cette réaction commence faiblement dès le mélange à froid puis à la chaleur du four, le dégagement de CO2 s’accentue et s’accélère.
En effet cette réaction est équilibrée avec une constante d’équilibre proche de 1. Le chauffage est favorable au dégazage de CO2 ce qui déplace l'équilibre jusqu’à la consommation totale du bicarbonate. Ainsi la pâte lève ; il se crée des alvéoles. Puis la pâte alvéolée se solidifie en gardant sa forme. Voilà c’est réussi !
Le composé secondaire formé HP2O73- est à la fois un acide et une base et seul dilué donnerait un pH voisin 7,3, soit un pH quasiment neutre. S’il reste du réactif initial H2P2O72- le pH serait alors légèrement inférieur à 7.
Pourrait-on utiliser du bicarbonate seul ?
C’est envisageable car il participe à l’équilibre 2 HCO3- = CO2 (gaz) + CO32- + H2O qui montre une formation possible de dioxyde de carbone et de carbonate. Toutefois le dégagement est quasi nul à froid, l’équilibre étant en faveur de HCO3- et ne se fait que lentement et de façon moindre à partir de 70 °C.
Le gâteau peut se solidifier avant que la pâte soit totalement levée. De plus l’ion carbonate CO32- formé en parallèle donne un milieu très basique au goût peu agréable.
Et le jus de citron ?
Quand l’eau est ajoutée sous forme de jus de citron (cake au citron, par exemple) cela introduit de l’acide citrique (iv) qui participe notablement à l’augmentation du dégazage. Il n’est en général pas totalement consommé ce qui donne ce petit goût acide caractéristique de cette pâtisserie. Mais ce n’est pas son seul rôle : il influence le caractère viscoélastique de la pâte à base de farine.
Que faire si on est en panne de levure chimique ?
Vous pouvez utiliser du bicarbonate de sodium et ajouter un peu de jus de citron.
Effervescence et analogie
On peut noter que toutes sortes de produits effervescents (dont des médicaments) présentent les mélanges bicarbonate et acide citrique ou bicarbonate et dihydrogénophosphate donnant du CO2 dès l’ajout d’eau.
Historiquement
Aux États Unis, c’est dans les années 1840 qu’apparait dans un livre de cuisine la proposition d’ajouter aux ingrédients d’une pâte de gâteau du bicarbonate de sodium et de la crème de tartre. Puis de nombreux essais ont été réalisés, y compris en Europe, pour sélectionner l’acide à ajouter avec le bicarbonate, la source d’amidon et les bonnes proportions. Les industriels ont alors vendu des mélanges prêts à l’emploi, aux proportions jalousement gardées.
Et le bicarbonate de sodium, matière première indispensable
Composé connu depuis l’Antiquité à l’état naturel, c’est le Français N. Leblanc qui a mis au point le premier procédé de fabrication à la fin du XVIIIe siècle [2], plus tard supplanté par le procédé Solvay [3]. Le premier producteur mondial est encore Solvay. Il existe des gisements naturels conséquents de bicarbonate aux États-Unis.
Le bicarbonate a de très nombreuses autres applications [3] [4].
Allez, à vos recettes !
Et n’oubliez pas de bien respecter les proportions. Les sachets vendus contiennent en général 10 g de levure à mélanger dans 500 g de farine. Un défaut de levure et le gâteau n’est pas levé, un excès de levure et le gâteau ne lèvera pas plus mais aura au final un arrière-gout de levure.
Françoise Brénon
(i) Cet additif alimentaire a pour code E500. Il est appelé baking soda dans les recettes américaines. Dans une des compositions lues sur les sachets, le terme « carbonates » avec un s (donc pluriel) est imprécis et fait penser à un mélange de carbonate ( CO32-) et d’hydrogénocarbonate. Ces composés appartiennent aux couples acides-bases CO2, H2O / HCO3- / CO32- dont les pKa sont 6,35 et 10,3 et jouent un rôle similaire.
(ii) Il s’agit du dihydrogénopyrophosphate disodique, codé E450i.
Le nom pyrophosphate de sodium indiqué sur un des sachets est imprécis. On pourrait penser à Na4P2O7 dont le nom précis est pyrophosphate tétrasodique. Mais celui-ci est une base ne pouvant donc réagir avec le bicarbonate pour donner du CO2. En réalité à l’analyse le produit contient aussi le E450i, soit H2P2O72-, comme dans les autres sachets. Les couples acidobasiques relatifs à l’acide pyrophosphorique sont : H4P2O7 / H2P2O7- / H2P2O72- / HP2O73- / P2O74- et les pKa correspondants sont 1,0; 2,5 ; 6,1 ; 8,5 (source « Les Réactions chimiques en solution », G. Charlot, chez Masson)
(iii) Ce diacide de formule semi-développée HOOC-CHOH-CHOH-COOH a pour nom précis l’acide 2,3-dihydroxybutanedioïque dont les pKa sont 3,0 et 4,4. Son code est le E334.
KC4H5O6 correspond au monoacide K+, -OOC-CHOH-CHOH-COOH.
Attention le mot courant « tartre » qui correspond au calcaire (CaCO3) qui se dépose sur les canalisations ou les bouilloires n’a aucun lien avec l’acide tartrique. Le nom « crème de tartre » provient des dépôts de tartrate sur les cuves en fin de processus de vinification.
(iv) L’acide citrique de formule HOOC-CH2-C(OH)COOH-CH2-COOH est un triacide de pKa 3,0 ; 4,4 ; et 5,7. Sa 1ère acidité est plus forte que celle de H2P2O72- et sa réaction sur HCO3- est totale.
Pour en savoir plus
[1] Zoom sur l’amidon sur le Site Mediachimie
[2] Bicarbonate de sodium - produit du jour (sur le site de la Société Chimique de France)
[3] Hydrogénocarbonate de sodium sur le site L’Élémentarium : propriétés, fabrication industrielle, applications
[4] le bicarbonate Solvay® (PDF) sur le site de Solvay
Le dioxyde de carbone : ami ou ennemi ? Le réchauffement climatique ne fait désormais plus aucun doute. Les climatosceptiques préfèrent maintenant discuter des causes. L’un de leur sujet de prédilection est le rôle supposé du dioxyde de carbone sur l’augmentation de la température sur Terre. Pourquoi le rôle du dioxyde de carbone dans le réchauffement climatique est-il si controversé ?
Terminale - Spécialité ST2S
Objectifs : Exprimer la composition de l’air sous forme de fractions molaires ou de pourcentages molaires et interpréter ces données.
Proposer des tests chimiques mettant en évidence la présence des gaz CO2, H2O et O2.
Thème 1 : Prévenir et sécuriser.
Partie : La sécurité chimique dans l’environnement.
Notions et contenus : Fraction molaire et pourcentage molaire.
Composition de l’air.
Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie
L’électrolyse un process largement répandu. Malgré son coût énergétique, l’électrolyse est largement utilisée dans l’industrie chimique, notamment pour préparer et purifier des métaux et non-métaux. D’autres applications jouent également un rôle important dans l’industrie de l’électrolyse. Les procédés de fabrication d’aluminium Al, de dichlore Cl2, de dihydrogène H2 ou d’eau oxygénée H2O2 utilisent cette technologie. L’électrolyse trouve aussi sa place dans d’autres domaines comme ceux de la protection contre la corrosion ou de la conservation d’anciens objets (en archéologie notamment). Cette activité a pour but de décrire le fonctionnement d’une électrolyse et d’illustrer ses domaines d’applications.
Terminale - Spécialité PC
Objectifs : Modéliser et schématiser, à partir de résultats expérimentaux, les transferts d’électrons aux électrodes par des réactions électrochimiques.
Déterminer les variations de quantité de matière à partir de la durée de l’électrolyse et de la valeur de l’intensité du courant.
Identifier les produits formés lors du passage forcé d’un courant dans un électrolyseur.
Relier la durée, l’intensité du courant et les quantités de matière de produits formés.
Constitution et transformation de la matière
Thème : Prévoir l’état final d’un système, siège d’une transformation chimique.
Partie : Forcer le sens d’évolution d’un système.
Notions et contenus : Passage forcé d’un courant pour réaliser une transformation chimique.
Constitution et fonctionnement d’un électrolyseur.
Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie
De nombreuses réactions d’oxydoréduction se déroulent en conditions biologiques comme dans les aliments que l’on mange. Ces transformations chimiques peuvent également expliquer les variations de couleurs exceptionnelles que l’on peut observer dans certains paysages. Maîtriser ces réactions reste essentiel pour étudier le fonctionnement d’une pile et mieux optimiser le stockage de l’énergie sous forme chimique.
Terminale - STL (Spécialités PCM et SPCL)
Objectifs : Étudier des réactions d’oxydo-réduction.
Relier la constante d’équilibre d’une réaction d’oxydoréduction aux potentiels standard des couples redox en jeu.
Étudier le fonctionnement des piles.
Transformation chimique de la matière / réactions d’oxydo-réduction
Notions et contenus : Couple oxydant / réducteur (redox).
Réaction d’oxydo-réduction.
Pile, anode, cathode.
Chimie et développement durable / composition des systèmes chimiques
Notions et contenus : Oxydo-réduction / Réaction d’oxydo-réduction.
Potentiel, potentiel standard.
Relation de Nernst, constante d’équilibre.
Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie
