test
Ingénieur de recherche / Chercheur (H/F)
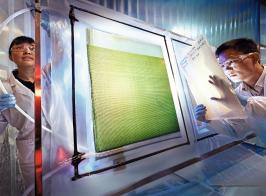
EN BREF
L’ingénieur de recherche ou chercheur est un concepteur, il est au cœur de l’innovation. Son métier consiste à créer de nouvelles molécules ou solutions techniques originales. L’ingénieur de recherche fait preuve de créativité, de rigueur, d’esprit d’équipe, de capacité de synthèse et d’analyse et d’envie d’apprendre. Il est un passionné persévérant.Faire preuve de créativité
L’ingénieur de recherche ou chercheur a la charge du « comment » dans le cadre d’un projet de recherche qu’il aura contribué à élaborer : recherche d’une nouvelle molécule active, d’une nouvelle application, de nouvelles propriétés physico-chimiques, des solutions nouvelles à des situations devenant critiques…
Il a une connaissance à la fois large et approfondie de la chimie et doit exercer une veille scientifique permanente ainsi qu’un état des lieux en temps réel des avancées de la concurrence.
Son haut niveau scientifique doit lui permettre d’imaginer et de mettre ou faire mettre en œuvre de nombreuses solutions alternatives permettant d’atteindre les objectifs définis.
Un travail d’équipe indispensable
Le chercheur peut travailler seul en tant qu’expert mais a souvent la responsabilité d’une petite équipe de techniciens qu’il a la responsabilité d’animer.
La recherche est une démarche pas à pas qui demande de la part du chercheur beaucoup de ténacité et nécessite en général la réalisation de beaucoup d’essais. C’est un travail d’équipe qui doit associer toutes les disciplines scientifiques connexes.
Présent dans beaucoup de secteurs d’activité
On trouve des ingénieurs de recherche dans tous les secteurs d’activité de la chimie et de la parachimie (cosmétiques, peintures, adhésifs, matériaux, agrochimie, verres, plasturgie, élastomères…) et dans d’autres secteurs (pharmacie, énergie, automobile, aéronautique, nucléaire, environnement…) dans la recherche privée en industrie ou dans la recherche publique.
Spécificités de la formation
Son niveau de formation en France ou à l’étranger va de BAC +5 (école ou université) à BAC+8 en fonction du domaine concerné. Après leur thèse, certains chercheurs font une ou plusieurs années en stage post-doctoral avec l’objectif de devenir des experts sur certains sujets spécifiques.
Ces formations se font en formation initiale ou dans certains cas dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.
Ressources associées
En savoir plus
- Chercheur(euse) en chimie : autres appellations et compléments d’informations sur le site Jetravailledanslachimie.fr
- Présentation du métier d’ingénieur chimiste sur le site de l’ONISEP
- Chargé(e) de recherche : autres appellations et compléments d’informations sur le site des Entreprises du médicament (LEEM)
- Les métiers de la recherche en sciences chimiques et sciences des matériaux au CNRS
Ingénieur brevets / Responsable brevets (H/F)

EN BREF
L’ingénieur ou responsable brevets a la responsabilité de protéger le capital-innovation de l’entreprise pour lui permettre de tirer les fruits de sa recherche et de sa créativité.La protection du patrimoine intellectuel
L’ingénieur ou responsable brevets a la responsabilité de rédiger, déposer et suivre les demandes de brevets de l’entreprise ou du laboratoire de recherche pour assurer la protection des droits de propriété industrielle. Les ingénieurs brevets sont présents dans tous les domaines technologiques et scientifiques dans les entreprises privées ou les laboratoires publics. Il a également un rôle de suivi et de conseil auprès de la direction de l’entreprise pour assurer, sur la durée, la protection juridique du patrimoine intellectuel et scientifique de l’entreprise.
L’activité s’exerce, soit au sein même de l’entreprise, soit au sein de cabinets spécialisés prestataires des entreprises.
Une double compétence scientifique et juridique indispensable
Ce métier nécessite en début de carrière une double compétence dans le domaine scientifique considéré et dans le domaine juridique spécifique à la propriété industrielle. Après quelques années d’expérience, l’évolution dans la fonction se fait au travers de l’examen de qualification européen et l’examen de qualification français qui permettent de devenir respectivement mandataire et conseil en propriété intellectuelle.
C’est un métier qui requiert à la fois des qualités scientifiques, de logique, de rigueur, des qualités rédactionnelles ainsi qu’un sens aigu des délais.
L’ingénieur ou responsable brevets travaille en interaction directe avec les équipes de R&D dans le cadre de la stratégie de l’entreprise en matière de protection industrielle.
Présent dans beaucoup de secteurs d’activité
L’ingénieur/responsable brevets peut exercer son métier dans différents secteurs tels que : chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, agroalimentaire, pétrole, plasturgie, caoutchouc, énergie, automobile, aéronautique, matériaux, nucléaire, environnement… dans la recherche privée en industrie ou dans la recherche publique.
Il peut également travailler dans un cabinet spécialisé en conseils en propriété industrielle.
Spécificités de la formation
Après une formation initiale à Bac+5 ou Bac+8, une formation complémentaire en droit des brevets est obligatoire (comme par exemple le
Ressources associées
En savoir plus
- Spécialiste en propriété intellectuelle (H/F) sur le site Jetravailledanslachimie.fr
- Exemple de formation en droit des brevets au CEIPI (Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle)
- Interview d'un ingénieur brevet sur le site du SIEP (Service d'Information sur les Etudes et les Professions)
Enseignant-chercheur (H/F)

EN BREF
L’enseignant-chercheur assure la double mission de transmettre des connaissances à ses étudiants en université ou en grandes écoles et de participer à la progression de la recherche dans sa discipline. Il est d’un esprit curieux et ouvert, il aime confronter les savoirs, produire de la connaissance et la transmettre.La recherche de l’enseignant-chercheur peut être fondamentale et appliquée et est validée par la publication d’articles. L’évolution de la recherche l’amène à participer à des colloques nationaux et internationaux. Son enseignement peut être sous forme de cours magistraux mais aussi de travaux dirigés et de travaux pratiques et l’amène à participer à la validation des étudiants. Il peut aussi être amené à coordonner une équipe pédagogique, mettre en place de nouveaux enseignements, participer à la vie administrative de l'université, encadrer des stages ou animer un réseau de chercheurs.
Les différents postes
Quand ils sont titulaires, les enseignants chercheurs débutent en général en tant que maître de conférences et peuvent évoluer ultérieurement en accédant à un poste de professeur des universités.
Il existe aussi des ATER (Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche) qui ont un CDD d'un an renouvelable une fois. Il s’agit en principe de jeunes venant d’obtenir leur doctorat. Assurer un poste d’ATER peut permettre d'améliorer les chances de postuler pour un poste de maître de conférences.
La répartition du travail
La charge d'enseignement est définie en durée horaire annuelle devant les étudiants, variable selon que l’on assure des cours, des TD ou des TP. Le reste du temps est consacré à la préparation des cours, des examens et à leur validation mais aussi bien sûr à la recherche.
Dans la pratique, les cours sont plutôt dispensés par les professeurs et les travaux dirigés et les travaux pratiques sont encadrés par les maîtres de conférences. Pour les ATER, la charge horaire est la même que pour les enseignants titulaires. Il existe aussi des postes d'ATER à mi-temps.
Comment postuler ?
Les postes à pourvoir paraissent au BOEN (Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale) et au JO (Journal Officiel). Ne sont autorisés à postuler que les candidats ayant obtenu leur inscription sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur, selon le poste à pourvoir. Un jury décide, sur titres, de l'inscription des postulants. Cette présélection tient compte de leur expérience préalable en enseignement, du contenu de la thèse et de son évaluation, de la poursuite d’une formation post-doctorale et du nombre et de la qualité des publications.
Évolution de carrière et conditions
L'évolution de carrière la plus importante est le passage de maître de conférences à professeur. Elle se fait exclusivement sur concours, principalement sur la base de son dossier de recherche et implique assez fréquemment une mobilité géographique. Outre la thèse, une habilitation à diriger les recherches (HDR) est demandée. L'habilitation à diriger les recherches (HDR) est un diplôme s'apparentant à une thèse, nécessitant la fourniture d'un document écrit et soutenue devant un jury universitaire. Ce document présente le bilan et les perspectives d'un certain nombre d'années de recherche (en général au moins cinq années).
Il est également possible de postuler directement à un poste de professeur, par exemple pour un chercheur CNRS ayant de l'ancienneté et sous réserve de correspondre aux critères de qualification.
Différence entre chercheur et enseignant-chercheur ?
Quelle différence avec un « chercheur » qui se consacre exclusivement à la recherche ? Suivant son statut, le chercheur sera recruté par concours national (CNRS, INRA...) ou par contrat de droit privé (CEA Energies Alternatives…) et n'aura pas de charge d'enseignement.
Spécificités de la formation
Le métier d’enseignant-chercheur est accessible après un BAC+8 (master recherche ou diplôme d’ingénieur suivi d’une thèse) puis une formation post doctorale (« post-doc »). Le diplôme d’HDR est nécessaire pour les postes de professeur.
Ressources associées
Directeur R&D / Directeur scientifique (H/F)

EN BREF
L’innovation est la raison d’être du directeur de la recherche et du développement (R&D) ou directeur scientifique. Les performances et les résultats futurs de l’entreprise pourront dépendre en grande partie de l’efficacité de la R&D qu’il dirige.La stratégie au cœur de l’activité
Le directeur scientifique ou directeur de la recherche et du développement définit les orientations et les projets de recherche en cohérence avec la stratégie de l’entreprise. Il met tout en œuvre pour les promouvoir et les coordonner. C’est un stratège qui a la capacité à convaincre et à conduire les hommes.
Il a la responsabilité de l’ensemble des équipes de R&D dont il doit assurer le développement et organiser au mieux les besoins en termes de moyens de recherche, équipements et budgets.
Il doit faire respecter la réglementation en ce qui concerne la sécurité, l’hygiène et l’environnement.
Un scientifique de très haut niveau
Il est d’un très haut niveau scientifique, le plus souvent pluridisciplinaire, et représente l’entreprise au sein de la communauté scientifique nationale et internationale.
Dans certaines entreprises, les rôles de directeur scientifique et directeur de la R&D sont dissociés. Les responsabilités sont alors partagées, le directeur scientifique ayant des responsabilités essentiellement scientifiques et le directeur de la R&D ayant à la fois un rôle scientifique et le rôle de management des hommes et des moyens. Dans ce cas, ils travaillent au quotidien en très étroite collaboration. Le directeur scientifique est généralement présent dans les grandes entreprises dont l’activité dépend de façon très importante de l’innovation.
Il y a souvent également une Direction de la recherche et une Direction du développement.
Présent dans beaucoup de secteurs d’activité
En fonction des organisations, on trouve des directeurs scientifiques et/ou des directeurs R&D dans de très nombreux secteurs d’activité : chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, agroalimentaire, pétrole, plasturgie, caoutchouc, énergie, automobile, aéronautique, matériaux, nucléaire, environnement… dans la recherche privée en industrie ou dans la recherche publique.
Spécificités de la formation
Le niveau de formation d’un directeur scientifique ou d’un directeur R&D va de BAC+5 (école d’ingénieurs ou université) à BAC+8 en fonction du domaine concerné, suivi très souvent d'une formation post doctorale.
Une très large expérience préalable dans le domaine est nécessaire avant de diriger la R&D.
Ressources associées
Agent de laboratoire / Aide-chimiste (H/F)

EN BREF
Pour qui aime la chimie et le travail en équipe, le métier d’agent de laboratoire ou aide-chimiste représente une porte d’entrée vers des activités de recherche, de procédés ou de production.Faire preuve de rigueur
L’agent de laboratoire a pour mission d’assister le technicien, le chercheur ou l’agent de maîtrise en contribuant à la préparation des différentes opérations de laboratoire ou d’atelier de procédés ou de production. Il peut être amené à reproduire des travaux standardisés sur la base de modes opératoires précis (montage d’appareillages, synthèse de produits, travaux d’analyse).
Des compétences techniques et scientifiques
Il a une formation technique et scientifique et opère dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur et de consignes strictes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Il doit avoir le sens de l’observation, être rigoureux et avoir un goût pour le travail en équipe.
Accompagné par une formation adaptée, il peut prétendre à évoluer vers des responsabilités de technicien.
La présence d’agents de laboratoire ou aides-chimistes n’est pas généralisée dans toutes les structures de R&D, elle dépend de l’organisation de chaque entreprise.
Présent dans beaucoup de secteurs d’activité
On peut trouver des agents de laboratoire dans de nombreux domaines d’activité : chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, agroalimentaire, pétrole, plasturgie, caoutchouc, énergie, automobile, aéronautique, matériaux, nucléaire, environnement… dans la recherche privée en industrie ou dans la recherche publique.
Spécificités de la formation
Le métier d’agent de laboratoire ou aide-chimiste est accessible après un
- CAP Industries chimiques
- CAP Employé technique de laboratoire
- Bac Pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons
en formation initiale ou dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.
En savoir plus
- Agent de laboratoire (H/F) sur le site Jetravailledanslachimie.fr
- Agent de laboratoire de recherche : autres appellations de ce poste et exemples complémentaires sur le site des Entreprises du médicament (LEEM)
- Focus Métiers Fabriquer sur le site lesmetiersdelachimie.com
- Exemples de débouchés pour un préparateur en chimie sur le site du CNRS
Technicien d’analyse chimie / physico-chimie (H/F)

EN BREF
Le technicien d’analyse chimie ou physico-chimie est spécialiste d’une ou plusieurs techniques apparentées. Il contribue à l’identification, la caractérisation ou le dosage d’un ou plusieurs composés chimiques.Le technicien d’analyse chimie ou physico-chimie met en œuvre les différentes méthodes d’analyse, dont les plus courantes sont la spectroscopie, la chromatographie et l’électrochimie, pour caractériser un produit au plan de la structure, mesurer sa pureté, contrôler sa stabilité ou suivre l’évolution d’une réaction chimique. La puissance d’investigation des techniques et des appareils ne cessent de progresser.
Les méthodes sont universelles et peuvent être mises en œuvre en recherche, en développement, en procédés ou en production. Certaines de ces méthodes sont également utilisées pour le dosage dans des milieux biologiques.
Compétences, innovation et travail d'équipe
Le technicien d’analyse chimie/physico-chimie a une formation en chimie, en analyse et en techniques d’analyse. Il fait preuve d’une très grande rigueur et possède une bonne capacité d’analyse. II peut être amené à mettre au point de nouveaux protocoles d’analyse.
Il travaille en général en laboratoire multitechniques, en collaboration étroite avec les équipes de chimistes. Il agit dans le cadre de la réglementation et se doit de respecter les règles en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Un poste présent dans de nombreux secteurs
Ce métier est présent dans toutes les branches de l’industrie. Pour ce qui concerne la chimie on le retrouve en R&D, dans la recherche privée en industrie ou dans la recherche publique, en procédés, en production et en analyse. Ce métier est également présent dans de nombreux autres secteurs d’activités : parachimie (cosmétiques, peintures, adhésifs, matériaux, agrochimie, verres, plasturgie, élastomères…) ainsi que dans les secteurs de la pharmacie, l'énergie, l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire, l'environnement…
Spécificités de la formation
Le métier de technicien d’analyse chimie ou physico-chimie est accessible après un BAC+2 (BTS ou DUT Chimie ou Mesures physiques) ou un BAC+3 (licence professionnelle Chimie ou Mesures physiques) en formation initiale ou dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.
Ressources associées
En savoir plus
- Technicien(ne) d'analyse chimie / physico-chimie sur le site Jetravailledanslachimie.fr
- Technicien(ne) de laboratoire de contrôle : autres appellations pour ce type de poste et compléments sur le site des Entreprises du médicament (LEEM)
- Un exemple de technicien d'analyse : technicien(ne) de police technique et scientifique sur le site de l'ONISEP
- Focus Métier Technicien d'analyse chimique sur le site lesmetiersdelachimie.com
Technicien de formulation (H/F)

EN BREF
Le technicien de formulation donne naissance au produit final sur la base d’un cahier des charges définissant notamment les caractéristiques physico-chimiques, l’activité et la stabilité du composé recherché. Le technicien de formulation doit avoir le sens de l’observation, être créatif, organisé et avoir le goût du travail en équipe.Des compétences pluridisciplinaires
En utilisant ses compétences dans les domaines de la chimie, de la physico-chimie et de l’analyse, le technicien de formulation a la responsabilité de mettre en œuvre des essais de mélanges ou combinaisons de produits et d’en effectuer les analyses. Le composé obtenu doit posséder des propriétés physico-chimiques spécifiques afin de répondre, dans des conditions d’utilisation ou d’administration particulières, au cahier des charges imposé.
La formulation, domaine en évolution permanente, fait de plus en plus appel aux sciences physiques et peut représenter un enjeu commercial décisif pour certains produits et certaines applications.
Présent dans beaucoup de secteurs d’activité
Le technicien de formulation exerce ses activités dans de nombreux secteurs : chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, agroalimentaire, colles, peintures, encres et vernis, pétrole, plasturgie, caoutchouc, énergie, automobile, aéronautique, matériaux, papiers spéciaux, nucléaire et énergies nouvelles, environnement… dans la recherche privée en industrie ou dans la recherche publique.
Spécificités de la formation
Le métier de technicien de formulation est accessible après BAC+2 (BTS ou DUT Chimie ou Formulation) ou BAC+3 (licence professionnelle Chimie ou Formulation) en formation initiale ou dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.
Ressources associées
En savoir plus
- Technicien(ne) formulation : autres appellations de ce poste et exemples complémentaires sur le site des Entreprises du médicament (LEEM)
- Focus Métier Technicien de formulation sur le site lesmetiersdelachimie.com
- Présentation du métier de formulateur - formulatrice sur le site de l’ONISEP
- Présentation du métier de formulateur dans les industries des peintures, encres et vernis sur le site Génération Industrie Peinture
Technicien Assurance Qualité (H/F)

EN BREF
Le technicien assurance qualité est un animateur de proximité dont le rôle est de faire passer sur le terrain auprès des équipes, la politique qualité de l’entreprise.La politique qualité d’une entreprise repose à la fois sur la réglementation en vigueur pour le secteur d’activité concerné et sur des règles propres à cette entreprise dépendant principalement de la nature de ses activités. Cette politique se traduit par la mise en place de critères de qualité.
Ses missions et ses outils
Le technicien assurance qualité a pour mission de sensibiliser et d’accompagner l’ensemble des salariés de l’entreprise dans la mise en œuvre de cette politique.
Ses outils sont les procédures, indicateurs, audits… qu’il contribue à élaborer, à diffuser parfois en faisant des formations, et à en contrôler l’efficacité sur le terrain.
Il peut être amené à mettre en place des actions préventives et correctives.
La politique qualité est applicable à tous les secteurs de l’entreprise mais est particulièrement développée au niveau des activités de R&D, de procédés et de production.
Son action s’applique à l’ensemble du personnel.
Compétences et qualités requises
Il doit bien connaître les activités, les équipements et les processus de l’entreprise.
Il a une formation en chimie et/ou en qualité et a une bonne maîtrise de la réglementation.
On lui demande de la rigueur, de la méthode, une capacité à travailler en équipe et à convaincre et un sens de la pédagogie.
De nombreux domaines et secteurs d'activités concernés
Ce métier est présent dans toutes les branches de l’industrie. Pour ce qui concerne la chimie on le retrouve en R&D, en procédés et en production. Il est aussi présent en parachimie (cosmétiques, peintures, adhésifs, matériaux, agrochimie, verres, plasturgie, élastomères…) et dans d’autres secteurs (pharmacie, énergie, automobile, aéronautique, nucléaire, environnement….).
Spécificités de la formation
Le métier de technicien assurance qualité est accessible après un BAC+2 (BTS ou DUT Chimie …) ou un BAC+3 (licence professionnelle chimie, assurance qualité…). Ces formations se font en formation initiale ou dans certains cas dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.
Spécialiste / Ingénieur Contrôle régulation / automatismes (H/F)

EN BREF
Le spécialiste ou ingénieur en contrôle régulation/automatismes a la responsabilité de la mise au point ou de l’adaptation de chaînes automatisées, de contrôles de régulation et de commande pour des équipements industriels ou de laboratoire.Faire preuve d’adaptabilité
Le spécialiste ou ingénieur en contrôle régulation/automatismes adapte le matériel commercial existant dont il gère l’approvisionnement ou conçoit de nouveaux équipements spécifiques en fonction du besoin de ses clients. Il supervise l’installation et en assure éventuellement la maintenance. Il assure une veille technologique dans son domaine de compétences.
Une conception bien pensée permettra d’améliorer la sécurité et la fiabilité des installations et ainsi d’en optimiser les coûts de fonctionnement.
Le spécialiste en contrôle régulation/automatismes travaillera aussi bien avec les équipes de R&D et d’analyse qu’avec celles de procédés et de production.
Il travaille dans le cadre de la réglementation et de règles strictes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Des compétences pluridisciplinaires
Ses compétences touchent à des domaines tels que le génie des procédés et le génie chimique, la régulation, l’instrumentation, l’informatique et l’électronique.
Il doit avoir le sens de l’écoute et une bonne capacité à la conduite de projet.
Il anime une équipe de techniciens qu’il a la responsabilité d’évaluer. Il doit aussi veiller à leur formation et à leur évolution.
Présent dans beaucoup de secteurs d’activité
Le spécialiste ou ingénieur en contrôle régulation/automatismes travaille dans tous les secteurs d’activité de la chimie, de la parachimie (cosmétiques, peintures, adhésifs, matériaux, agrochimie, verres, plasturgie, élastomères...) et d’autres secteurs (pharmacie, énergie, automobile, aéronautique, nucléaire, environnement…).
Spécificités de la formation
Son niveau de formation est à BAC+5 (ingénieur ou Master Pro) plus particulièrement spécialisé en automatisme, contrôle et régulation. Ces formations se font en formation initiale ou dans certains cas dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.
Technicien Contrôle industriel et régulation automatique (H/F)

EN BREF
Le technicien de contrôle industriel et de régulation automatique adapte, installe et entretient les équipements de contrôles automatisés.Des réponses spécifiques à des besoins diversifiés
Il est en charge de la mise en œuvre de systèmes automatisés pour des équipements de R&D et d’analyse, de procédés ou de production et en particulier pour les processus fonctionnant en continu. Il peut être associé à la conception des outils et en assure l’installation et la maintenance. Son rôle est important dans la sécurité, la fiabilité et la qualité des installations. Il travaille en général en collaboration avec les utilisateurs et connaît les contraintes des installations industrielles.
Des compétences diversifiées
Le technicien de contrôle industriel et régulation automatique a des compétences dans les domaines de la régulation analogique et numérique, l’instrumentation, les automatismes, la physique appliquée et le génie des procédés.
Il agit dans le cadre de la réglementation et du respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Présent dans beaucoup de secteurs d’activité
On trouve des techniciens en contrôle industriel et régulation automatique dans tous les secteurs d’activité de la chimie, pétrochimie, de la parachimie (peintures, adhésifs, matériaux, agrochimie, verres, plasturgie, élastomères, cosmétiques…) et d’autres secteurs (pharmacie, automobile, aéronautique, nucléaire, métallurgie, cimenterie, pâte à papier, environnement…).
Spécificités de la formation
Le métier de technicien contrôle industriel et régulation automatique est accessible au niveau BAC+2 (BTS le plus souvent un BTS Contrôle et régulation automatique) ou BAC+3 (licence professionnelle Régulation, Automatisme ou Ingénierie systèmes automatisés…) en formation initiale ou dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.
