L'année 2019 est celle du 150e anniversaire de la publication par Mendeleiev de son tableau périodique des éléments. À cette occasion Mediachimie vous propose de découvrir le tableau périodique et ses éléments avec des quiz.
L'année 2019 est celle du 150e anniversaire de la publication par Mendeleiev de son tableau périodique des éléments. À cette occasion Mediachimie vous propose de découvrir le tableau périodique et ses éléments avec des quiz.
Publication d’une nouvelle édition du Vocabulaire de la chimie et des matériaux
Rubrique(s) : Événements
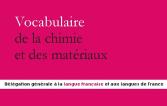
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France vient de publier une édition revue et augmentée du Vocabulaire de la chimie et des matériaux paru pour la première fois en 2007 : 582 termes et définitions concernant des notions nouvelles dont beaucoup n’avaient pas de désignation en français.
Voir sur le site de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France
Télécharger : Vocabulaire de la chimie et des matériaux (2018) PDF - 1271 Ko
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France publie une édition revue et augmentée du Vocabulaire de la chimie et des matériaux paru pour la première fois en 2007 : 582 termes et définitions concernant des notions nouvelles dont beaucoup n’avaient pas de désignation en français.
Voir sur le site de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France
Télécharger : Vocabulaire de la chimie et des matériaux (2018) PDF - 1271 Ko
La peste de l’étain a-t-elle contribué à la tragédie de la retraite de Russie des armées napoléoniennes ?
En savoir plus : La Bérézina : quand le métal devient poussière ou la guerre sans bouton. Mythe ou réalité ?
L’exploration spatiale, habitée et robotique, est au carrefour de divers enjeux scientifiques, technologiques, politiques. Politiquement, ces programmes sont un moyen pour les nations de démontrer leurs compétences ou leur leadership, et sont aussi le vecteur de coopérations bi ou multilatérales. Ils mobilisent des ressources humaines et financières importantes et font appel à des outils technologiques à la limite des possibilités du moment.
Même si les raisons scientifiques ne sont pas toujours la motivation principale, en particulier pour l’exploration spatiale habitée, la question scientifique centrale sous-jacente est celle de l’émergence de la vie dans l’univers. On passe ici en revue les destinations possibles et les technologies nécessaires ainsi que leurs liens avec les technologies non spatiales. On évoque en particulier la complémentarité homme/robot, en remarquant qu’un programme de vol habité qui se limiterait à des activités en orbite basse n’a guère d’intérêt. Au passage, on dissipe certaines illusions (e.g. « terraforming » de Mars, retombées économiques de la micropesanteur). On dessine ensuite les perspectives d’un programme d’exploration qui serait réalisé dans une véritable coopération internationale, en mettant en avant comme objectif raisonnable la réalisation d’une base lunaire sur le modèle de la recherche en Antarctique. On examine enfin le rôle que pourrait jouer dans un tel programme l’Europe, c’est à dire l’Agence Spatiale Européenne, l’Union Européenne et leurs États-membres.
Source : Colloque Chimie, aéronautique et espace, 8 novembre 2017, Fondation de la Maison de la chimie
 |
Journées du Patrimoine à Saint-Véran (15 et 16 septembre 2018)
|
Journées du Patrimoine à Saint-Véran (15 et 16 septembre 2018)
Rubrique(s) : Événements

Venez participer aux Journées du Patrimoine à la Maison du Soleil à Saint-Véran les 15 et 16 septembre 2018 autour des thèmes Cadrans solaires de Saint Véran et au-delà et Cristaux, mines de cuivre et océan.

Samedi 15 Septembre
Cadrans solaires de Saint-Véran et au-delà
- 15h - 17h : Atelier cadrans solaires (6 - 15 ans)
- 17h30 : Visite autour des cadrans solaires de Saint-Véran (adultes et enfants)
- 18h30 : Conférence : L'art et l'histoire des cadrans solaires haut-alpins par Elsa Giraud (adultes et enfants)
Dimanche 16 Septembre
Cristaux, Mine de cuivre et Océan alpin
15h - 17h : Atelier fabrication de cristaux (6 - 15 ans)
17h - 19h : Conférence sur l'histoire géologique de l'océan alpin et de la mine de cuivre de Saint-Véran par Raymond Cirio (adultes et enfants)
Toutes les activités sont gratuites.
Contact :
Maison du soleil - Saint-Véran - Hautes-Alpes
04 92 23 58 21
www.saintveran-maisondusoleil.com
contact@saintveran-maisondusoleil.com
 |
La chimie des feux de forêts
|
La chimie des feux de forêts
Rubrique(s) : Éditorial

L’actualité de cet été 2018 a été marquée par les annonces et descriptions de feux de forêts. Le Portugal, la Grèce, la Suède, la Californie ont été les théâtres de gigantesques incendies très médiatisés où l’élévation de température (1) ou des actes criminels (2) ont eu leurs rôles. Des centaines de milliers d’hectares et habitations ont été détruites malgré les grands moyens de lutte mis en action. Quelles sont les réactions chimiques présentes lors de ces embrasements et de leurs extinctions ?
Lors d’un feu de forêt, hors de la combustion du carbone des végétaux qui dégagent des oxydes de carbone CO2 et CO (3), de nombreux composés organiques volatils (4) sont présents dans les fumées issues de la pyrolyse de la cellulose. Ces composés ont été très étudiés par le CEREN en fonction du type de végétaux :
- pour le chêne les fumées contiennent des composés benzéniques et phénoliques tels que C6H6, C7H8, du furfural C5H4O2, l’acide acétique, le p-crésol sont aussi présents, mais peu de terpènes ;
- pour les ajoncs, buissons épineux et broussailles de sous-bois les fumées sont riches en benzène (5), toluène, xylène et acide acétique, mais pas de terpènes ;
- pour le pin au contraire on trouve dans les fumées beaucoup de terpènes et peu de composés phénoliques.
Tous ces composés volatils qui se dégagent lors de la pyrolyse sont très inflammables et dès qu’ils rencontrent les conditions favorables de température et de concentration en oxygène ils transforment les arbres en torches incandescentes quasi explosives telles que nous les décrivent les pompiers sur place.
Hors les principes de préventions mis en place notamment en France et en Europe du Sud, comment lutter contre les incendies lorsqu’ils se sont déclarés ? Les principes sont toujours les mêmes :
- faire baisser la température de combustion (750 °C - 400 °C)
- priver les composés carbonés d’accès à l’oxygène de l’air
C’est pourquoi depuis toujours on arrose les flammes avec de l’eau (6). Sa chaleur latente de vaporisation très élevée permet à l’eau de puiser des calories au brasier et de faire baisser la température. Sa vapeur remplace l’oxygène de l’air.
Depuis les années 1960, on y ajoute des retardateurs de combustion non toxiques pour l’environnement. Ce fut d’abord des ajouts d’argile (7) en suspension comme la bentonite qui recouvre d’une couche les végétaux et retarde la pyrolyse. Puis des hydroxydes d’aluminium, [Al(OH)3], ou de magnésium, Mg(OH)2, qui à température élevée délivrent de l’eau et donnent les oxydes Al2O3 ou MgO réfractaires.
Actuellement les moyens aériens et additifs largués se sont perfectionnés. On distingue trois types d’ajouts :
- les retardateurs tels que les polyphosphates d’ammonium avec des argiles comme l’attapulgite dilués dans l’eau à 20 % ;
- les agents mouillants de types tensioactifs ;
- des agents moussants (8) comme l’hexylène glycol (ou 2-Methyl-2,4-pentanediol) et le n-octanol qui isolent de l’air le végétal par une couche de mousse adhérente.
Les techniques d’attaque du front de flamme se sont perfectionnées avec les célèbres canadairs qui en quelques secondes larguent 1/3 de leur charge de 7 m3 sur les flammes et 2/3 sur la végétation avant qu’elle soit atteinte par les flammes. On y ajoute un colorant qui est souvent l’oxyde de fer Fe2O3 de couleur rouge pour que les avions suivants voient bien la trace du largage précédent. Et que dire du supertanker de Boeing le 747–400 qui peut larguer en 10 secondes 72 m3 de mélanges que l’on a vu en action en Californie ? Mais finalement ne vaut-il pas mieux suivre en forêt les recommandations de prudence de la protection civile et des pompiers pour éviter la première flamme ?
Jean-Claude Bernier
Août 2018
Pour en savoir plus :
(1) Chimie atmosphérique et climat
(2) La chimie mène l’enquête
(3) Nom de code : CO2
(4) Pollution et feux de cheminées
(5) Sur la structure du benzène
(6) L’eau : ses propriétés, ses ressources, sa purification
(7) Biogéochimie et écologie des sols
(8) Les secrets des mousses, une interview de Claude Treiner
 |
Chimie et canicule
|
Chimie et canicule
Rubrique(s) : Éditorial

La fin du mois de juillet et le début d’août 2018 sont marqués par des températures notablement supérieures à la moyenne et plusieurs départements français ont été mis en vigilance canicule. Ces problèmes de chaleur touchent une partie de la population, surtout en milieu urbain. Comme il n’est pas facile de « mettre les villes à la campagne » comme le souhaitait Alphonse Allais, il s’agit de mettre en œuvre les moyens de lutter contre ces températures extrêmes dans les habitations, dispositifs où la chimie est largement sollicitée.
Essayons de se rappeler quelques éléments simples de thermodynamique. Dans un fluide gazeux les zones chaudes migrent inévitablement vers les zones froides. Pour un solide, sa conduction thermique facilite plus ou moins le transfert des calories du chaud vers le froid. Pour un liquide, en fonction de la température et de la pression, la vapeur est en équilibre avec le liquide. Pour passer de l’état liquide à l’état vapeur, il faut fournir une certaine quantité d’énergie qui est l’enthalpie de vaporisation qu’on appelle parfois chaleur latente et qui diffère suivant les formules chimiques des liquides (pour l’eau : 2260 kJ/kg, pour l’alcool 855 kJ/kg).
Premier moyen donc : améliorer l’isolation thermique des bâtiments (1), ce qui est valable en hiver l’est aussi en été. Isolation des combles par la laine de verre, de roche ou de cellulose, doublage des cloisons externes par le polystyrène expansé, double vitrage à lame d’argon, permettent de placer des barrières à très bonne isolation entre l’extérieur et l’intérieur (2).
Deuxième moyen : utiliser un liquide à bonne chaleur latente et l’évaporer à l’intérieur car il va pomper les calories et évacuer les vapeurs à l’extérieur pour les recondenser en évacuant les calories grâce à un échangeur. C’est le principe du climatiseur en utilisant un fluide frigorigène comme des chlorofluoroéthanes (maintenant interdits) ou l’ammoniac qui ont des températures d’ébullition assez basses sous des pressions compatibles avec des installations domestiques.
On peut aussi utiliser de petits ventilateurs refroidisseurs qui utilisent l’évaporation d’un film d’eau, car l’eau a une forte chaleur latente, capables de refroidir de quelques degrés une pièce de la maison.
Le problème des grandes villes est plus large (3), car elles possèdent des « îlots de chaleur », en centre-ville le béton, le goudron, absorbent la chaleur le jour et la restituent la nuit et la température nocturne reste élevée. La forme et l’implantation des bâtiments et surtout la végétalisation sont de nature à refroidir l’atmosphère (4). En effet, les arbres font de l’ombre et leurs feuilles rejettent la vapeur d’eau. Lors des fortes chaleurs, il peut y avoir 3°C de différence entre le Bois de Boulogne et le centre de Paris. En ville, moins utiliser la climatisation mais avoir plutôt recours au réseau de froid urbain (5) qui utilise de l’eau naturelle glacée et qui permet d’économiser plus de 90 % de gaz à effet de serre. Avoir des revêtements clairs réfléchissant les rayonnements, remplacer le goudron par des pavés granit plus poreux et moins absorbants sont les éléments d’une nouvelle politique de la ville. Enfin la circulation automobile (6), n’oublions pas que le moteur thermique même s’il émet du CO2 émet aussi des calories car le rendement d’un moteur thermique (7) est de l’ordre de 40% ceci veut dire que 60 % des 44000 Kj/kg d’essence servent à chauffer l’atmosphère des villes. Demandez donc de nouvelles pistes cyclables et roulez en vélo mais avec un bidon d’eau fraiche.
Jean-Claude Bernier
Août 2018
Pour en savoir plus
(1) La discrète révolution de la performance énergétique des bâtiments
(2) Vivre en économisant cette « chère » énergie
(3) Les défis des grandes villes : apports possibles des chimistes
(4) Impact de la végétation sur le microclimat urbain et la qualité de l’air
(5) Le réseau de froid urbain
(6) La mobilité urbaine
(7) Le moteur électrique comparé au moteur thermique : enjeux et contraintes
Rencontre très pédagogique avec Patrick Couvreur et les chercheurs du laboratoire de recherche à l’origine de ces nouveaux médicaments, pour comprendre comment la chimie permet d’encapsuler les principes actifs dans des molécules nanovecteurs pour délivrer le médicament spécifiquement au niveau de la cellule malade.
Cette technologie améliore l’activité thérapeutique et diminue la toxicité. Elle est particulièrement intéressante pour les médicaments anticancéreux. La vidéo permet de suivre les principales étapes de la fabrication en laboratoire.
Source : Clins d'oeil de la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie
