Source : Grand Prix Jeunes Journalistes de la Chimie 2018
De la recherche à la production, les chimistes participent à la protection et l’embellissement du corps au quotidien, pour la santé et le bien-être. La dermo-cosmétique concerne la création de produits de soin afin d’assurer l’hygiène et l’intégrité de la peau tout en préservant l’éclat d’une beauté naturelle. La beauté, idéal qui change avec les époques, les régions et les modes, fait appel à la mise au point de produits pour le maquillage et les cheveux qui confèrent à ceux-ci et à la peau un éclat ou des contrastes de couleurs. Dans ces domaines, la France est le leader mondial et l’industrie cosmétique est le 4e secteur de l’économie française.
Source : Série Les chimistes dans
Il y a cinq siècles, les conquistadors découvraient en Amérique du Sud une substance au caractère sacré secrétée par certains arbres. Les Améridiens la moulaient et, après séchage à la fumée, s’en servaient comme balle ou toiles enduites. D’ailleurs, les jeux comme « le juego de pelota » sont les ancêtres de la pelote basque ou même du foot-ball. [...]
En 1902, Sabatier et Senderens procédèrent à la synthèse du méthane CH4 sur nickel et cobalt à partir d’un mélange de monoxyde de carbone CO et d’hydrogène H2. Le premier brevet a été déposé ensuite en 1913 en Allemagne par BASF sur la préparation d’huiles à partir d’un gaz de synthèse sur catalyseur cobalt-osmium Co-Os. [...]
Source : Grand Prix Jeunes Journalistes de la Chimie 2018
Source : Grand Prix Jeunes Journalistes de la Chimie 2018
 |
De la chimie pour tutoyer les étoiles ?
|
De la chimie pour tutoyer les étoiles ?
Rubrique(s) : Éditorial
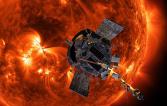
En octobre, la sonde PSP (Parker Solar Probe) va entamer sa première révolution autour de Vénus pour accélérer en profitant de l’assistance gravitationnelle et se lancer dans sa première ellipse autour du Soleil en novembre. Il convient alors de rappeler comment la chimie (1) est concernée par cette exploration historique.
« Toucher le soleil » (2) est un vieux rêve que l’humanité et les scientifiques caressent avec envie depuis Icare. Le Soleil est en effet un gigantesque laboratoire où la fusion nucléaire, la gravité géante, la physico-chimie des plasmas et les tempêtes magnétiques posent autant de problèmes physiques inexplorés qu'ils suscitent de soifs de savoirs.
La couronne solaire s’étend sur plusieurs millions de kilomètres et est composée d’hydrogène, d’hélium, de carbone et d’ions de métaux de transitions. C’est là que sont générés les vents solaires qui se déploient à travers tout notre système planétaire. La température y est d’un million de degrés Celsius, soit 300 fois la température de surface du Soleil (5500°C). C’est dans la perspective d’étudier cette couronne que la sonde PSP va s’en approcher progressivement, jusqu’à une distance de 6 millions de km en 2024 lors de sa dernière rotation. Même à cette distance qui équivaut à plusieurs fois le rayon du Soleil, la température peut avoisiner 1300°C et le rayonnement émis est 600 fois supérieur à celui que vous avez peut-être reçu sur la plage cet été (3).
La sonde PSP embarque de multiples instruments et capteurs auxquels des laboratoires et équipes de chercheurs français ont collaboré pour étudier la vitesse et la densité du vent solaire : la caméra pour visualiser des parties de la couronne, le détecteur magnétique pour étudier les champs électriques et magnétiques, le capteur pour mesurer l’énergie des particules, ions, électrons et protons issus des éruptions solaires... (4).
Par exemple, le laboratoire de physique et chimie de l’environnement et de l’espace (LCP2E) d’Orléans a réalisé et assemblé le magnétomètre à induction SCM (Search Coil Magnetometer) pour l’étude ses champs dans le plasma. Le Laboratoire de physique des plasmas (LPP) à l’École polytechnique a conçu un spectromètre assemblé aux États-Unis pour étudier les turbulences du vent solaire. L’Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse (IRAP) est sollicité pour l’interprétation des images de la caméra.
Tous ces instruments, circuits et capteurs doivent pouvoir résister aux rayonnements et hautes températures. Les circuits électriques et une partie de l’électronique (5) sont réalisés à base de niobium et de tungstène, métaux réfractaires à hautes températures de fusion. Il faut même un bouclier protecteur de ces instruments, de 2,4 mètres de diamètre, épais de plus de 11 cm et composé de deux panneaux en fibres de carbone (6) séparés par un sandwich de mousse de carbone et, sur la face qui sera exposée au Soleil, une couche céramique blanche réfractaire et réfléchissante.
Ces équipements ont été testés au laboratoire du CNRS PROMES qui dispose à Odeillo d’enceintes sous vide pour tester des objets de grande dimension à plus de 2000°C grâce au four solaire.
Les résultats des mesures devraient pouvoir permettre de connaître les processus de la surchauffe fantastique de la couronne sous l’influence d’ondes électromagnétiques et comprendre l’origine des tempêtes de vents solaires dont les vitesses de 200 à 800 km/s ont érodés la Lune et la planète Mars (7), faisant disparaître toute trace de vie et provoquant sur notre terre des perturbations électriques et magnétiques qui peuvent avoir des répercussions dramatiques dans les télécommunications et le climat (8).
Jean-Claude Bernier
Septembre 2018
Pour en savoir plus :
(1) La chimie et l’espace
(2) Spectre et composition chimique du soleil (vidéo)
(3) De la terre au soleil (vidéo)
(4) Fusion au cœur des étoiles (vidéo)
(5) De la chimie au radar du Rafale
(6) Les nouveaux matériaux composites pour l’aéronautique
(7) De la chimie sur Mars
(8) Le changement climatique : question encore ouverte ?
Portes Ouvertes de la Chimie !
Rubrique(s) : Événements

Les entreprises de la Chimie font découvrir leurs activités et leurs savoir-faire au public dans toute la France.
Pour les découvrir, rendez-vous sur le site internet dédié.
L'année 2019 est celle du 150e anniversaire de la publication par Mendeleiev de son tableau périodique des éléments. À cette occasion Mediachimie vous propose de découvrir le tableau périodique et ses éléments avec des quiz
L'année 2019 est celle du 150e anniversaire de la publication par Mendeleiev de son tableau périodique des éléments. À cette occasion Mediachimie vous propose de découvrir le tableau périodique et ses éléments avec des quiz.
