Un salon automobile très chimique
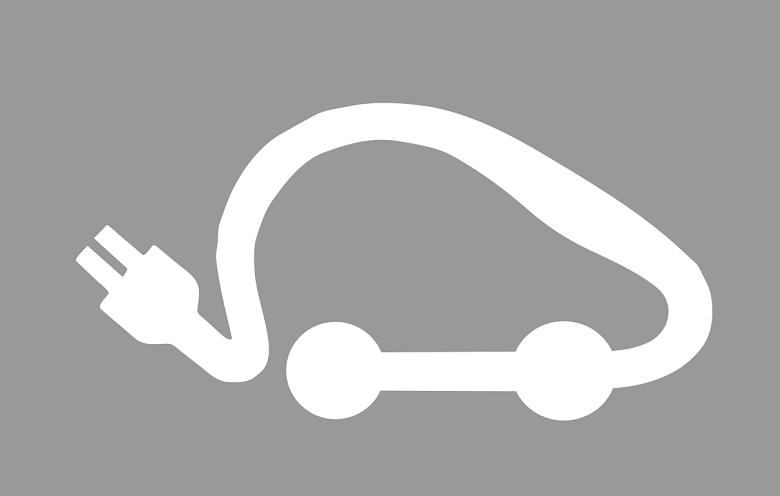
À Paris se tient du 14 au 18 octobre le salon « Equip Auto » qui les années impaires remplace le salon mondial qui reviendra en 2026 à Paris. Sur cinq halls Porte de Versailles, 1 400 constructeurs et sous-traitants exposeront les dernières innovations sur la mobilité automobile. La liste des exposants est impressionnante, mais on peut discerner les thèmes majeurs : la transition énergétique, la digitalisation, l'économie circulaire et l'acceptabilité.
Ce salon tombe à un moment charnière où l'industrie automobile européenne traverse une période mouvementée avec le passage du moteur thermique à l'électrique, induisant le doute chez les clients et en conséquence la baisse générale des ventes, accélérée par la concurrence chinoise. Bruxelles a réagi sous la pression des constructeurs en ajustant les droits de douane aux frontières de l'Europe et en soutenant la fabrication des batteries européennes, essentielles pour l'automobile à l'horizon 2035, si on ne veut pas que s'écroule cette part de l'industrie sur notre continent.
La chimie des matériaux
À chaque stade de l'innovation en matière automobile, nous retrouvons la chimie des matériaux (1) :
- L'allègement des plateformes et des carrosseries où les nouveaux alliages d'aluminium et les matériaux composites ont la part belle (2).
- Les alliages de cuivre (Cu-Be, Cu-Ni-Sn) pour les moteurs électriques et les faisceaux conducteurs. Dans un véhicule électrique, on trouve près de 100 kg de cuivre, cinq fois plus que dans une automobile classique. Pas étonnant que le cours de ce métal atteigne des sommets !
- La fabrication des composants pour les nombreux capteurs dont sont bourrés la plupart des nouveaux véhicules : caméras, radars de proximité, accéléromètres, et les calculateurs embarqués pour la « conduite intelligente ». Ils exigent des quantités remarquables de semi-conducteurs à base de silicium et de carbure de silicium ultra-purs pour les puces, sans compter les liaisons conductrices en or ou argent-palladium (3).
- L'incroyable chimie des batteries ion-lithium où sont passés maîtres les fabricants asiatiques. C'est ici le point stratégique pour l'Europe et la France. Sans maîtrise industrielle de leurs fabrications, c'en est fini de l'industrie automobile et des millions d'emplois.
Une chimie essentielle et stratégique pour le transport automobile.
La chimie des batteries ion-lithium
Les véhicules électriques sont en grande majorité équipés de batteries ion-lithium (4). La production mondiale approche en 2024 près de 1 200 GWh, dont 85 % pour les véhicules électriques. On connaît maintenant assez bien le fonctionnement de ces batteries :
- À l'anode, le graphite intercale le lithium : LiC6 ↔ C6 + Li⁺ + e⁻
- À la cathode, l'oxyde LiMO2 libère le lithium en changeant le degré d'oxydation du métal.
Au départ, ce métal était le cobalt qu'on a progressivement remplacé par le nickel et le manganèse pour obtenir les cellules NMC (811) où la composition de la cathode est LiNi0,8Mn0,1Co0,1O2. L'électrolyte est un sel organique conducteur mais inflammable qui peut parfois poser des problèmes de sécurité. Les progrès en fabrications industrielles conduisent maintenant à un optimum de stockage pour des millions de batteries NMC : 250 Wh/kg.
Vient cependant, par un vent asiatique puissant, une vraie concurrence depuis trois ans : celle des batteries LFP (lithium fer phosphate) qui met en jeu une nouvelle chimie à la cathode constituée d'un phosphate de fer lithium : LixFePO4 ↔ xLi⁺ + (1-x)FePO4. L'anode est toujours constituée de graphite et l'électrolyte est organique. Progressivement, on a réussi à optimiser le potentiel de charge en substituant au fer le manganèse qui peut changer d'états d'oxydation plus riches que le fer (Mn 4-3-2), Fe (3-2), si bien que l'on obtient couramment 180 Wh/kg pour les batteries LMFP avec une cathode de formule LiMnxFe1-xPO4.
Les compositions chimiques des batteries lithium industrielles résultent toujours d'un compromis. Pour les NMC, on diminue la concentration en cobalt, issu majoritairement de la République du Congo dans des conditions humanitaires parfois scandaleuses et au cours très volatil, en le remplaçant par le nickel, mais pas trop car le nickel favorise l'emballement thermique. Pour les LFP, la tension est plus faible, 3,5 V au lieu de 3,8 V, mais il n'y a plus de métal critique (Co, Ni), la charge est plus rapide, ils sont moins sensibles aux variations de température et engendrent moins de problèmes de sécurité. Si bien que sur les véhicules électriques, alors qu'en 2021 on trouvait environ 25 % de LFP, on atteint plus de 40 % en 2025 et cela va encore augmenter, porté par la vague des fabricants chinois.
Car il y a des différences entre les capacités d'une cellule et celle d'un pack de batteries. Dans une automobile, deux systèmes sont possibles : CTP (cell-to-pack) où les assemblages de cellules sont déposés dans un réceptacle aménagé dans le plancher de la carrosserie avec son électronique de régulation et de protection thermique, ou CTC (cell-to-car) où les packs de batteries font partie intégrante de la carrosserie. Cette dernière solution est particulièrement favorable aux LFP, débarrassées de leur encombrante électronique de capteurs et de régulation de la charge et de la température des NMC. Leur nombre de cellules par volume est plus important et la capacité totale en Wh d'un véhicule s'approche de ceux équipés en NMC, et cerise sur le gâteau pour un prix 20 % moindre.
La difficile industrialisation
Une chimie complexe, laquelle choisir ? (5) Des matières premières ultra-pures (carbonate de lithium, graphite, sulfates de métaux de transition) disponibles hors Europe. Des adhésifs sur couches minces sophistiqués, des chaînes de fabrication tournant à plusieurs milliers de cellules/h, on comprend que la mise en route des gigafactories européennes ne soit pas un fleuve tranquille.
En France, cinq de ces usines sont présentes : ACC (Total, Stellantis, Mercedes), Verkor (Renault, Arkema, Schneider…), AESC (Chine, Japon, US), Prologium (Taiwan) – quatre dans les Hauts-de-France – et Blue Solutions (Bolloré) en Bretagne et Alsace. Sauf peut-être Bolloré qui travaille sur la batterie tout solide avec l'anode en lithium métal depuis près de 20 ans et commence à maîtriser la production industrielle, toutes peinent à la maîtriser. Car tout en étant une production de masse, c'est une véritable orfèvrerie.
Les producteurs français ont en tête l'échec du suédois Northvolt et ont supplié l'Europe de les accompagner lors de cette phase critique de démarrage des chaînes. ACC et Verkor, européennes, vont recevoir environ 200 millions d'euros de Bruxelles en 2026 pour leur donner les moyens de concurrencer en qualité les géants chinois comme CATL et BYD qui maîtrisent 60 % du marché et ont plus de 10 ans d'avance dans ce secteur industriel.
Encore faut-il que le marché suive et là, en Allemagne suite à l'arrêt des subventions aux particuliers et en France avec la diminution de celles-ci pour l'achat des VE, les ventes stagnent ou diminuent. Il importe donc que les constructeurs français et européens se mettent à proposer des petites voitures électriques sur un segment comparable aux « kei cars » japonaises : moins de 3 m de long, 200 km d'autonomie, moins de 15 000 euros et des batteries françaises.
On rappellera qu'avec notre mix électrique, la batterie fabriquée en France émet 10 fois moins de GES que celle fabriquée en Chine. Il en va donc de notre souveraineté mais aussi d'un bilan environnemental (6), énergétique et financier qui effacera les 50 milliards d'importation de pétrole remplacés par l'électricité intérieure produite dans l'Hexagone. Avant que nous ayons tous des VE chinois, c'est une politique agressive d'aide à l'achat de véhicules électriques made in France que nous voudrions voir menée.
Jean-Claude Bernier
Octobre 2025
Pour en savoir plus
(1) Matériaux critiques et axes stratégiques pour l’industrie automobile, G. Bureau, Colloque Chimie et matériaux stratégiques, Fondation de la Maison de la Chimie (novembre 2022)
(2) Les alliages d’aluminium pour l’allègement des structures dans l’aéronautique et la carrosserie automobile, B. Dubost, Colloque Chimie et transports, Fondation de la Maison de la Chimie (avril 2013)
(3) Quels matériaux pour les transitions énergétiques et digitales ?, A. Nominé, Colloque Chimie et matériaux stratégiques, Fondation de la Maison de la Chimie (novembre 2022)
(4) Avancées et perspectives dans le domaine du stockage électrochimique de l’énergie (batteries), D. Larcher, Colloque Chimie et énergies nouvelles, Fondation de la Maison de la Chimie (février 2021)
(5) Meilleurs matériaux pour batterie à ions lithium, l’approche déductive et inductive du chimiste, J.-M. Tarascon, cours vidéo collège de France
(6) Nouveaux véhicules électriques et thermiques : quel impact sur l’environnement ?, J.-C. Bernier, Colloque Chimie et énergies nouvelles, Fondation de la Maison de la Chimie (février 2021)
Crédit illustration : Roulex 45, travail personnel, wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0
