Cadmium, je t'aime… moi non plus
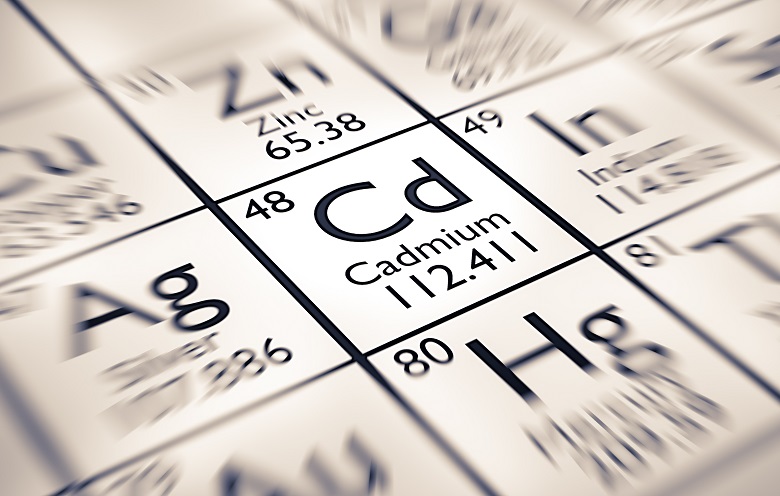
Il est rare que les médecins généralistes se manifestent dans les medias et fassent la « une » dans les journaux. C’est ce qui est arrivé en juin lorsque leur association a parlé d’une « bombe sanitaire » concernant l’imprégnation de la société française par un métal lourd : le cadmium.
Qu’est-ce que le cadmium ?
Le cadmium (Cd) est un métal blanc de numéro atomique 48 découvert en Allemagne par quatre chimistes dont Frédéric Strohmeyer, élève de Vauquelin, en 1817 (1)(2).
Présent dans les minerais de zinc, dont il est un co-produit, il est obtenu industriellement par pyrométallurgie lors du raffinage du zinc. Les « éponges de cadmium » obtenues sont d’abord purifiées à la soude puis traitées à haute température par distillation du cadmium à 770°C. Ce procédé laisse place maintenant à l’hydrométallurgie et à la purification par électrolyse.
Près de 50% du métal est obtenu par recyclage des batteries Ni/Cd qui constituaient jusqu’au développement des batteries Li/ion son principal usage. L’autre utilisation est celle des pigments en peinture (3) avec son sulfure CdS jaune, ajouté dans les plastiques, les verres et les céramiques.
Sa présence à côté du zinc dans de nombreuses utilisations en fait un métal largement répandu comme polluant, sa faible température de fusion et surtout sa faible température de vaporisation (767°C) entraînent sa présence dans les poussières et calamines métallurgiques.
Les sources
Le cadmium est naturellement présent dans les roches à l’état d’oxyde Cd(II), et lorsqu’elles se dégradent, elles le libèrent dans le sol (4). C’est particulièrement vrai pour les sols calcaires en Champagne, en Charente, dans le Jura et dans les Causses. Il est aussi présent comme impureté dans les minerais de phosphates naturels de calcium, dont les principales mines se trouvent au Maroc et en Tunisie, servant à la fabrication d’engrais minéraux phosphatés. Les procédés chimiques de fabrication des engrais ne peuvent l’éliminer. Ainsi l’utilisation de ces engrais dans l’agriculture (5) contribue à élever la concentration en cadmium (II) dans les végétaux cultivés. On le retrouve ensuite dans les aliments de base comme les pommes de terre, le pain, les pâtes…
Il peut être aussi inhalé par les poussières dans les zones industrielles de métallurgie du zinc ou du cuivre. La teneur est de l’ordre de 1 ng/m3 dans l’air, plus de 10 ng/m3 en zone industrielle et près de 30 µg/m3 près de l’Etna. Mais nul besoin d’aller si haut ; les gros fumeurs aspirent de bonnes doses dans les fumées de leurs cigarettes : 20 cigarettes apportant 2 µg.
En 2007, l’Ademe estimait les apports à 54% par les engrais, 28% par les déjections animales, 14% pour les retombées atmosphériques, et 5% pour les boues et composts.
Imprégnation et toxicité
La toxicité du cadmium n’a été soupçonnée qu’au milieu du XXe siècle avec l’augmentation de la production et de la demande industrielle qui, d’une quinzaine de tonnes en 1900, est passée à plus de 20 000 tonnes en 2000 !
À l’état oxydé Cd2+, le cadmium, qui n’a pas d’activité biologique comme le zinc (II) ou le fer (II) et (III) qui sont des oligoéléments (6), n’est pas métabolisé et s’accumule chez les mammifères dans le foie, les reins et divers organes comme le pancréas chez l’homme. Les faibles doses de cadmium se concentrent dans la chaîne alimentaire dans les feuilles des plantes, salades, choux, tabac, et dans les graines, blé, riz, maïs, tournesol et cacao (7) qui seront consommées. Il s’accumule aussi dans les mollusques et certains poissons (cabillaud, merlu) mais aussi dans les abats d’animaux d’élevage.
L’ANSES et Santé publique avaient souligné dès 2010 le caractère cancérigène et reprotoxique du cadmium et témoignaient de leur souci avec l’augmentation des cancers du pancréas en France. Car entre 2005 et 2015 l’imprégnation au cadmium a quasiment doublée chez les adultes. Elle était 3 fois supérieure à celle des adultes américains et 2 fois supérieure à celle de nos amis italiens. Chez les enfants, la comparaison avec les mêmes pays est encore plus alarmante.
Comment diminuer notre exposition ?
Depuis 2024 et suite au rapport de juillet 2021 sur l’imprégnation de la population française, Santé publique France et les agences régionales de santé ont mis au point un réseau de surveillance concernant les dosages des créatinines urinaires de Cd2+ et des dosages dans le sang pour certaines cohortes. De même, une plateforme de surveillance alimentaire (8) a créé un groupe auquel participe l’INRAE sur le cadmium en France et dispose de plus de 75 000 résultats d’analyses publics ou privés couvrant l’alimentation humaine et animale. Suite à ces mobilisations plusieurs recommandations et actions ont été émises ou réalisées :
- limiter l’usage d’engrais de synthèse qui en 20 ans a déjà été réduit de 70% ;
- imposer une teneur maximale dans les phosphates de synthèse ;
- sélectionner les variétés végétales qui accumulent le moins de cadmium. C’est ainsi qu’une unité de recherche de l’INRAE a trouvé une variété de blé qui diminue fortement sa teneur dans les grains tout en préservant le rendement ainsi que les teneurs en fer et en zinc ;
- pour certaines parcelles de culture de blé dur produisant des récoltes qui dépassent le seuil autorisé (0,18 mg Cd/kg de grains), l’INRAE a de nouveau développé un outil « Bléssûr » qui permet de prédire la non-conformité et alerte le producteur ;
- la dépollution des sols par les plantes (9) : en effet, certaines plantes ont la capacité naturelle de « suraccumuler » les métaux lourds. Les exemples les plus connus sont ceux de la phytoremédiation des sols pollués comme les anciennes friches industrielles. On peut sélectionner des espèces particulièrement accumulatrices du cadmium sur ces terres polluées. Cette voie est encore en exploration.
Les voies possibles sont nombreuses. La surveillance de la sécurité et de la conformité alimentaire a fait d’incontestables progrès. La population française se trouve largement en dessous des normes de la valeur limite biologique du cadmium de 4 µg/L dans le sang (4 ppm). Les valeurs moyennes sont :
≤ 0,2 µg/L pour les moins de 12 ans, ≤ 1 µg/L pour les adultes et ≤ 2 µg/L pour les gros fumeurs.
Jean-Claude Bernier et Françoise Brénon
(1) Cadmium sur le site Produits du jour de la SCF
(2) Cadmium sur le site de l’Elementarium
(3) La chimie crée sa couleur… sur la palette du peintre, B Valeur, La chimie et l’art (EDP Sciences, 2010) isbn : 978-2-7598-0527-3
(4) Chimie et sols, quiz (Mediachimie.org)
(5) La chimie, alliée indispensable et responsable de la nutrition des plantes, N. Broutin, Colloque Chimie et Agriculture durable, (novembre 2021), Fondation de la Maison de la Chimie
(6) Les métaux dans l’alimentation : un bienfait ou un danger ?, B. Meunier, Colloque Chimie et Alimentation (février 2025), Fondation de la Maison de la Chimie
(7) Le chocolat est-il bon pour la santé ?, M. Barel, La chimie et l’alimentation (EDP Sciences, 2010) isbn : 978-2-7598-0562-4
(8) Réglementation de l’évolution des risques alimentaires : la place de la chimie, V. Baduel, La chimie et l'alimentation, EDP Sciences, 2010) isbn : 978-2-7598-0562-4
(9) Zoom sur la phytoremédiation des métaux lourds, J.-P. Foulon, Zoom sur… (Mediachimie.org)
Crédit illustration : antoine2k / Adobe Stock
